Vie quotidienne
La
basse-cour
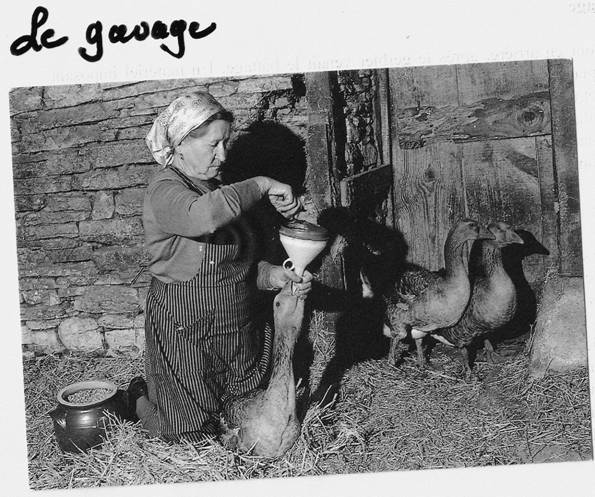 Avec le maïs, on alimentait
la basse-cour. Il servait au gavage des oies et des canards ainsi qu’à
l’alimentation des volailles et des cochons pour la consommation familiale. Au
moment de l’abattage des animaux, on invitait les voisines et la famille. Il
fallait plumer les canards une fois ébouillantés alors que les oies étaient
plumées à sec, la plume et le duvet soigneusement réservés
pour la literie. Au lendemain de l’abattage, il fallait décarcasser, découper
les quartiers et mettre au sel mais surtout prélever les foies. Quelle joie
lorsque apparaissait un foie souvent pesant le kilo. Le bocal actuel n’existait
pas. Il n’y avait que des boîtes métalliques qu’il fallait faire sertir par un
artisan possédant la machine et qu’il fallait ensuite cuire au stérilisateur
comme maintenant ; les foies étaient mis en boîte avec de la truffe qui
leur donnait un parfum incomparable. A cette époque, la truffe abondait dans le
pays et dans la cuisine. Les quartiers étaient cuits dans la graisse dans le
grand chaudron de cuivre, sur le feu et plus tard sur le gaz. Pour cette
cuisine, ma mère mettait un tablier blanc et surveillait la cuisson. Aussitôt
retirés de la graisse, les quartiers étaient rangés dans les pots en grès (les
« toupines ») et recouverts de graisse fine. Une fois refroidi, ils
étaient coiffés de papiers blancs et rangés à la cave, plus tempéré pour la
conservation. Du chaudron, on retirait encore les fritons et les carcasses.
C’était un régal de les goûter tout chaud comme ça l’est encore à ce jour.
Avec le maïs, on alimentait
la basse-cour. Il servait au gavage des oies et des canards ainsi qu’à
l’alimentation des volailles et des cochons pour la consommation familiale. Au
moment de l’abattage des animaux, on invitait les voisines et la famille. Il
fallait plumer les canards une fois ébouillantés alors que les oies étaient
plumées à sec, la plume et le duvet soigneusement réservés
pour la literie. Au lendemain de l’abattage, il fallait décarcasser, découper
les quartiers et mettre au sel mais surtout prélever les foies. Quelle joie
lorsque apparaissait un foie souvent pesant le kilo. Le bocal actuel n’existait
pas. Il n’y avait que des boîtes métalliques qu’il fallait faire sertir par un
artisan possédant la machine et qu’il fallait ensuite cuire au stérilisateur
comme maintenant ; les foies étaient mis en boîte avec de la truffe qui
leur donnait un parfum incomparable. A cette époque, la truffe abondait dans le
pays et dans la cuisine. Les quartiers étaient cuits dans la graisse dans le
grand chaudron de cuivre, sur le feu et plus tard sur le gaz. Pour cette
cuisine, ma mère mettait un tablier blanc et surveillait la cuisson. Aussitôt
retirés de la graisse, les quartiers étaient rangés dans les pots en grès (les
« toupines ») et recouverts de graisse fine. Une fois refroidi, ils
étaient coiffés de papiers blancs et rangés à la cave, plus tempéré pour la
conservation. Du chaudron, on retirait encore les fritons et les carcasses.
C’était un régal de les goûter tout chaud comme ça l’est encore à ce jour.
La cuisine
du cochon
Elle se faisait au cours de l’hiver. Il fallait
faire appel au tueur, c’est à dire l’homme qui allait de ferme en ferme pour
saigner et dépecer les cochons. Cela nécessitait deux interventions : le
matin, de bonne heure, c’était la mise à mort. Il fallait à hommes solides pour coucher le cochon sur la mée. Le tueur le saignait et je prenais le sang dans une bassine sans cesser de le remuer
pour confectionner le boudin. Le cochon roulé dans la mée
était ébouillanté et raclé vivement par les hommes pour le débarrasser de ses
poils. Aussitôt propre, il était placé et attaché sur l’échelle dressée,
suspendu par les pattes arrières. Là, on affinait sa
toilette puis on l’ouvrait pour retirer les entrailles réservées à la
confection des boudins ; le nettoyage des boyaux était long.
Le soir, le tueur revenait, il découpait toute la
viande en morceaux divers : d’abord les deux jambons puis les deux
épaules, ensuite les filets, la viande à saucisse et celle pour les pâtés, les
os en petit salé ... Ma mère, aidée de ma tante, confectionnait le boudin et le
faisait cuire lentement à petit feu. Le lendemain, elles faisaient la saucisse
que l’on pliait en anneaux réguliers à la barre dans la cuisine ainsi que tout
le reste de la cuisine du cochon. Il fallait bien compter trois jours pour en
venir à bout car un cochon de 150 kilos
en moyenne donnait beaucoup de viande. Ainsi se constituaient les réserves
familiales. Poulets et lapins venaient s’ajouter, les poules produisaient des
œufs et en cas de réforme faisaient d’excellentes poules au
pot bien farcies !
La chasse
Dès l’automne, c’était l’ouverture de la chasse. Il
y a toujours eu des chasseurs dans la famille pour goûter de bons civets. Les
lièvres étaient plus abondants qu’aujourd’hui. Ma mère savait bien les préparer
et j’essaie de continuer la recette. La période hivernale donnait lieu à de
nombreuses parties de chasse. Mon grand-père, grand braconnier, mon père expert
à découvrir le lièvre au gîte, mon mari et nos enfants ont été des chasseurs
assidus. Il y avait aussi les parties de furetage car les lapins proliféraient.
Les chasseurs supportaient sans bouger le froid glacial pour tirer les lapins
traqués par le furet à la sortie du clapier.
Mais le soir, autour d’un bon souper et du vin
nouveau, les exploits de la journée étaient vivement discutés ; ensuite,
la partie de carte complétait la soirée.
La truffe
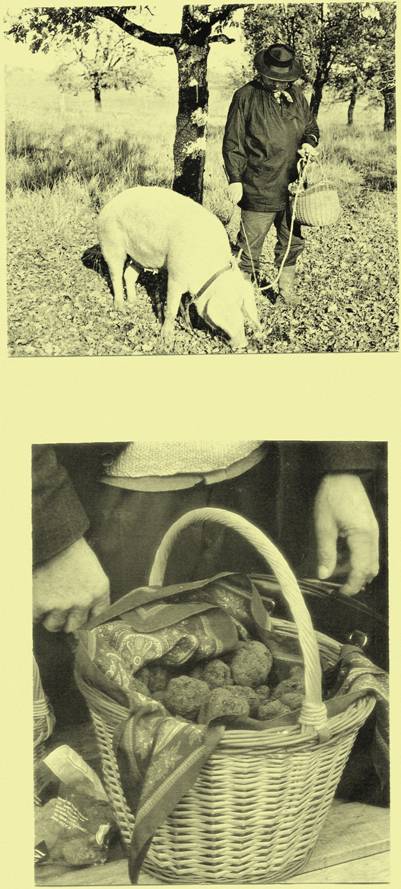
Avec l’hiver venait la saison de la truffe. Mon grand-père
truffait avec une truie adulte, mon père avec un porcelet qu’il fallait dresser
pour cela. Il cachait dans la terre des morceaux de truffe, faisait passer
plusieurs fois le porcelet à cet endroit jusqu'à ce qu’il en trouve et là, les
lui laissait manger. C’était un travail de patience. Lorsqu’il y avait pris
goût, il la cherchait de lui même. Alors, plus question de la lui laisser
manger ; lorsqu’il l’avait découverte, il fallait habilement le retenir pour
avoir la truffe avant lui, l’empêcher de la dévorer et le récompenser de
quelques gourmandises. En effet, un cochon est parfois capricieux mais c’est un
travail passionnant. Truffer avec un chien est bien plus simple. Il gratte à
l’endroit où il a senti la truffe, à soi de la découvrir et de le récompenser.
Mais s’il boude et ne veut pas travailler, on ne rapporte rien. Il y a environ
une trentaine d’années, la vente de la truffe participait largement au
bien-être des agriculteurs. Les marchés avaient lieu à Sauzet
et étaient très renommés. Les marchands expéditeurs y venaient de loin. Puis
une coopérative se créa, elle payait bien et embauchait du personnel. Mais
hélas la gestion ne fut pas bien conduite et ce fut la faillite avec pertes et
fracas ! De plus après la forte gelée de 1956, jamais vu dans notre
région, la truffe diminua d’années en années et à ce jour, on n’en trouve plus
que vers Lalbenque et il en vient de l’étranger. A
l’époque florissante des marchés aux truffes, Sauzet
avait quatre restaurants, deux cafés, deux boucheries, deux épiceries, une
mercerie, une modiste, un forgeron, un coiffeur, la halle avec le commerce des
graines et tous les étalages divers dans la rue. Il est bien loin ce temps
là !
Le bois
Au cours de l’hiver, il fallait couper le bois de
chauffage pour l’hiver suivant. On abattait d’abord les gros chênes au
« passe-partout », longue scie pourvue d’un manche à chaque extrémité
que l’on tire à deux personnes par un mouvement régulier de va et vient. La
scie pénètre dans le bois et lorsque l’arbre commence à bouger, il faut
pressentir où il va se coucher. En le poussant fort, il s’abat avec fracas. Ensuite, il faut le débiter par
tronçon d’un mètre environ puis en faire des tas prêts à charger. Le branchage
est aussi débité pour en faire des fagots. Ceux-ci, attachés avec une liane
souple, servent pour allumer et accélérer le feu. Le bois reste en tas jusqu'à
l’été suivant où, bien sec, il assurera le chauffage. Ainsi s’écoulait l’hiver
et nous arrivions peu à peu au printemps.
La lessive
Quand les jours se faisaient assez chauds, on
procédait à la grande lessive annuelle. Pour cela, mon père installait le
« cuvier » au coin de la cour. Le cuvier était un récipient rond en
bois blanc, à large embouchure, de un mètre de haut environ et muni d’un trou
d’écoulement. Ma mère mettait le linge à tremper, c’est à dire une bonne
vingtaine de gros draps, du linge de maison et les chemises d’hommes en toile
blanche. Le lendemain, on effectuait un savonnage vigoureux et on replaçait le
linge dans le cuvier. D’autre part, ma mère préparait le « lessif », c’est à dire une chaudière d’eau bouillante
dans laquelle elle versait un grand seau de cendres et des cristaux de soude.
Après repos, elle arrosait le linge avec ce lessif
très chaud. Elle effectuait patiemment cette opération toute la journée. Le
lendemain, le linge égoutté et placé dans des corbeilles d’osier blanc était
conduit avec le charreton et le cheval à la rivière, la Séoune.
Mon père faisait un barrage en travers du ruisseau avec des pierres et une
grosse planche devant. On s’agenouillait sur des sacs remplis de paille et, à
deux, on déployait les draps dans le courant et on les tapait sur la planche.
Cela demandait l’après-midi et souvent, un petit goûter était le bienvenu. Le
lendemain, les draps étaient étalés sur la prairie et retournés pour un bon
séchage puis, enfin, soigneusement pliés avant d’être rangés dans l’armoire
pour une autre année. Plus tard, la lessiveuse a permis de laver plus souvent
et plus rapidement et utilisait en bouillant le même principe d’arrosage. Mais
lorsque apparue la machine à laver qui vint s’installer dans la maison vers
1955, ce fut un soulagement considérable bien qu’elle fut moins perfectionnée
qu’aujourd’hui.
Les
déplacements
Dans ma toute jeunesse, ils étaient très simples, à
pied le plus souvent pour mes aïeuls. Mon grand-père, marchand de moutons,
n’hésitait pas à aller les acheter à Lalbenque ou
Caussade et, dans la semaine, les revendre à Saint-Sylvestre
ou Villeneuve sur Lot en faisant marcher le troupeau. Mes parents, mieux
nantis, avaient un cheval et sa voiture, ou plutôt charreton. Nous allions
ainsi aux foires de Montcuq et de Sauzet, mais je
n’étais pas toujours du voyage. Ma mère se déplaçait souvent ainsi pour les
marchés et les commissions. Le vélo fut le principal véhicule de ma jeunesse
mais il me fallut le gagner en vendangeant à 1 franc le panier. C’est mon oncle,
André Dellard, qui me l’acheta à Prayssac.
Lorsque je l’ai vu, j’en ai pleuré de joie et le soir je l’ai pris dans ma
chambre ! Pendant la guerre, ma mère fit aussi du vélo mais mon père
n’apprit jamais. Les voitures automobiles étaient le privilège des plus riches
et de ceux assez persévérants pour affronter le permis de conduire. Ici, il y
en avait seulement deux pour le village. Les attelages à cheval étaient les
plus nombreux. Lorsque la guerre, l’essence manqua très vite. On fit alors des
coupes de bois que l’on faisait brûler en gros tas. Ce charbon alimentait un
système d’énergie appelé gazogène qui faisait fonctionner les voitures
indispensables et quelques autobus.